
Nous jonglons tellement facilement en clinique avec les émotions, les cognitions et les comportements, qu’on en oublierait presque que les TCC ne résultent pas d’un mariage d’amour entre l’approche comportementale et l’approche cognitive, plutôt d’un mariage de raison!
C’est en effet un peu contrainte que l’approche comportementale, historiquement première arrivée, a dû faire un peu de place à l’approche cognitive. Il faut dire que cette dernière a mis de plus en plus souvent en évidence les lacunes de la première, en proposant une alternative… que la première s’est empressée de disqualifier ! Cela se passe souvent de cette façon entre les modèles concurrents, à ceci près qu’habituellement un des deux fini par disparaître, ce qui n’a pas été le cas ici.
Sur le terrain clinique, face à la souffrance des patients, on fait feu de tout bois. Le but est de construire un corpus de démarches les plus efficaces possibles, et plus on dispose d’outils qui marchent, mieux c’est a priori. En tous cas jusqu’à la proposition d’une définition plus large de ce qu’un modèle thérapeutique basé sur les preuves doit remplir comme critères. Qui plus est, même les plus déterminés des comportementalistes percevaient bien qu’ils flirtaient avec les cognitions dès qu’ils commençaient à parler avec leurs patients. Au fil du temps, chacun a su reconnaître les apports de l’autre et les intégrer à sa pratique, et si certains cliniciens se disent aujourd’hui plutôt d’approche cognitive quand d’autres se définissent plutôt d’approche comportementale, pour dire vrai, les pratiques sont le plus souvent comparables. Et puis, en France, l’histoire de cette alliance s’est aussi écrite dans la querelle avec les tenants de l’approche psychanalytique, et comme le chantait Brassens, « dès qu’il s’agit d’rosser les cognes, tout l’monde se réconcilie » ! (*smiley qui rigole en fumant la pipe*)
Chez les chercheurs en revanche, ces deux écoles de pensée n’ont jamais vraiment collaboré, pour dire le moins. C’est toujours la même histoire : dès qu’on se désigne par des mots en « isme », les positions deviennent quasi politiques, voire religieuses. Pour les deux camps qui s’opposent ici, le schisme est bien réel. A ma gauche les comportementalistes. Pour eux, la cause des comportements est à rechercher dans l’environnement. A ma droite les cognitivistes, pour qui les comportements sont causés par les cognitions. Une petite différence d’appréciation direz-vous. Un gouffre au contraire ! Car de ces prémisses découlent des conceptions radicalement différentes de la thérapie. Schématiquement, les comportementalistes essaieront d’atteindre des modifications de l’environnement, afin que les comportements problématiques s’ajustent à ces changements. Les cognitivistes, quant à eux, privilégieront la transformation des cognitions (via notamment la fameuse « restructuration cognitive ») en visant en retour la transformation des comportements en lien avec ces cognitions.
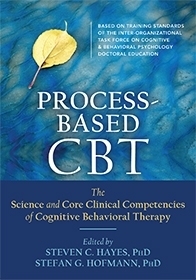 En psychologie clinique, cette période d’affrontement théorique est peut-être en passe d’être de l’histoire ancienne, comme le démontre la publication de l’ouvrage collectif « Process-Based CBT », dirigé par un des grands noms de chaque « camp » et auquel j’ai eu la chance de contribuer.
En psychologie clinique, cette période d’affrontement théorique est peut-être en passe d’être de l’histoire ancienne, comme le démontre la publication de l’ouvrage collectif « Process-Based CBT », dirigé par un des grands noms de chaque « camp » et auquel j’ai eu la chance de contribuer.
En effet, au jeu de la causalité, bien que résolument environnementaliste, l’ACT accorde une place certaine aux cognitions. L’ACT s’inscrit dans une approche dite « contextuelle », c’est-à-dire qu’elle considère chaque comportement comme un acte dans un contexte, dont il est dépendant autant qu’il y contribue. La subtilité est ici que le contexte –un synonyme d’environnement- est à définir du point de vue de chaque comportement. On ne peut pas définir le contexte dans l’absolu, par avance, par exemple en déterminant qu’il regroupe tout ce qui se passe en dehors de nous. Pour chaque comportement, le contexte est composé de l’environnement physique, de l’environnement social, mais aussi de ce que nous percevons à l’intérieur de nous (la proprioception), de notre histoire, et des cognitions alors présentes. Il s’agit d’un ensemble dynamique, dans lequel les cognitions jouent un rôle.
Lorsqu’on pratique la défusion dans l’ACT, on ne cherche pas à changer directement des cognitions considérées comme problématiques, mais à modifier le contexte cognitif dans lequel ces cognitions apparaissent. On travaille donc bel et bien sur des cognitions, mais sur celles qui constituent l’environnement de la cognition à l’origine de la souffrance. Les cognitions sur lesquelles on travaille sont elles-mêmes causées par d’autres éléments de l’environnement (entre autres, le thérapeute qui conduit vers la défusion) et s’inscrivent elles-aussi dans un contexte cognitif (par exemple l’évaluation de la sollicitude ou de l’efficacité du thérapeute par le patient).
Le centre de cette réconciliation est la reconnaissance d’un intérêt commun pour les processus psychologiques, c’est-à-dire la mise en avant du plus petit dénominateur commun aux comportementalistes et aux cognitivistes. Plus que de grands principes, les processus sont directement testables, dans leur efficacité comme dans leur mode d’action. Le juge arbitre est donc reconnu de tous, puisqu’il s’agit de la méthode scientifique.
On ne peut que se réjouir de la mise en route de ce processus de paix, qui conduira peut-être à la disparition des « ismes », au profit d’une approche transdiagnostique processuelle.
Bibliographie
Voir aussi l’article en ligne:
Le chapitre que j’ai co-rédigé avec Steven Hayes et David Sloan Wilson sur les processus evolutionnistes:
2 comments for “Processus de paix”